Le 1er octobre dernier, les conseillers numériques des Alpes-Maritimes se sont réunis pour leur journée annuelle départementale. Dans ce cadre, ICOM’provence a eu l’opportunité d’animer un atelier dédié à l’accueil des publics en situation de handicap.
Un accompagnement n’est véritablement universel que s’il anticipe et répond aux besoins de tous les citoyens, y compris ceux qui font face à des barrières physiques, sensorielles ou cognitives. Cet article revient sur les trois axes méthodologiques que nous avons partagés durant cet atelier, conçus pour outiller les professionnels sur le terrain.
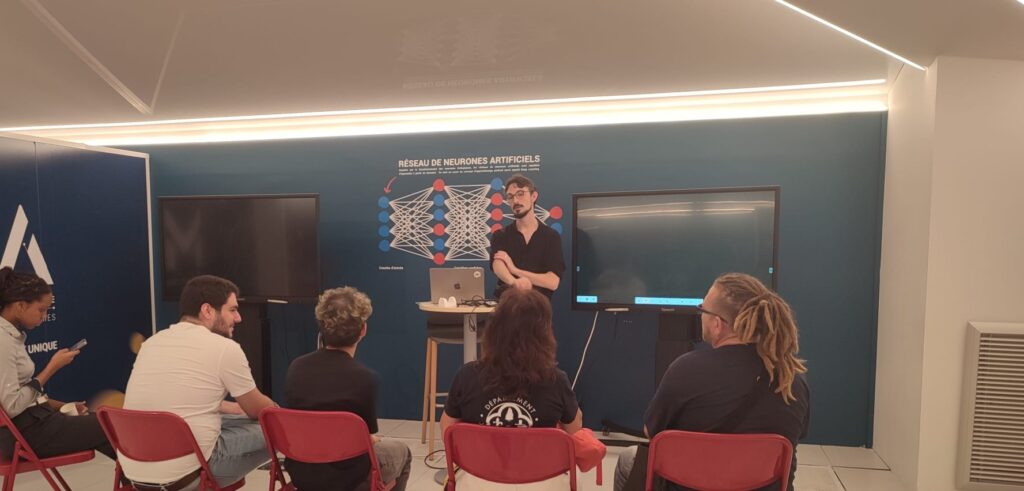
1. Comprendre la notion de « situation de handicap »
Une démarche d’inclusion efficace commence par une redéfinition de la notion même de handicap. Plutôt que de la percevoir comme une caractéristique intrinsèque à une personne, il est plus juste et opérationnel de parler de « situation de handicap ». Cette approche, issue du modèle social du handicap, postule que c’est l’interaction entre une personne ayant une déficience et un environnement inadapté qui crée la barrière et l’exclusion.
Au cours de l’atelier, un exercice de mise en situation a permis aux participants de l’expérimenter : un texte illisible à cause d’une police trop petite, une vidéo sans sous-titres, un site web non navigable au clavier… Ces exemples concrets ont pour but de démontrer que c’est l’environnement (numérique ou physique) qui est « handicapant ».

Dans cette situation, la personne est-elle en situation de handicap ? Non, elle peut accéder en toute autonomie à son ordinateur, l’environnement est adapté à sa difficulté.
2. Démystifier les aides techniques numériques
La technologie, souvent perçue comme une source de complexité, peut également être une formidable solution. Une partie de notre atelier a été consacrée à la démonstration d’aides techniques, ces dispositifs matériels ou logiciels qui compensent une difficulté.
Parmi les exemples présentés :
- Les dispositifs de pointage alternatifs : Les souris ergonomiques verticales, les trackballs ou les joysticks sont des solutions pour les personnes ayant des troubles musculo-squelettiques ou une motricité fine limitée.
- Les guides-doigts : Une simple plaque de plexiglas perforée, placée sur un clavier standard, permet de guider les doigts et d’éviter les frappes accidentelles pour les personnes ayant des tremblements ou des difficultés de coordination.
- Les fonctionnalités d’accessibilité natives : Nous avons également insisté sur les solutions logicielles déjà intégrées aux systèmes d’exploitation (Windows, macOS) : loupe d’écran, contrastes élevés, lecture vocale, reconnaissance vocale, etc. Connaître et savoir activer ces options constitue une première réponse, gratuite et immédiate.
L’objectif de cette présentation n’était pas de former des experts en matériel adapté, mais de montrer que des solutions existent, qu’elles sont souvent accessibles et qu’elles peuvent transformer radicalement l’expérience d’un usager.
3. Élaborer un plan d’action pragmatique et progressif
La prise de conscience et la connaissance des outils ne suffisent pas si elles ne se traduisent pas par des actions concrètes. L’un des freins souvent évoqués est la contrainte budgétaire ou le manque de temps. C’est pourquoi la dernière phase de l’atelier s’est concentrée sur la co-construction d’une feuille de route pour l’accessibilité, réaliste et adaptée aux moyens de chaque structure.
La méthodologie proposée se décline en plusieurs étapes :
Auditer : Évaluer l’existant. L’accueil est-il accessible physiquement ? Le matériel informatique dispose-t-il d’options d’accessibilité activables ? Le site web de la structure respecte-t-il les standards de base ? Cette première photo de la situation est indispensable pour identifier les points de friction majeurs.
Préparer l’inclusion : Il s’agit ici de mettre en place les fondations d’un accueil réellement inclusif. Cela passe par des actions préventives et organisationnelles à fort impact, comme :
- Rendre les supports plus accessibles : Revoir les documents (supports de cours, fiches d’inscription, affiches) pour utiliser des polices de caractères lisibles, des contrastes de couleurs suffisants et une mise en page aérée.
- Créer un processus interne pour identifier les besoins : L’anticipation est la clé. Intégrer au processus d’inscription une question ouverte, posée de manière systématique et bienveillante, peut tout changer. Par exemple : « Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, rencontrez-vous des difficultés particulières (visuelles, motrices, de concentration…) pour participer à un atelier numérique ? » Cette simple question permet de se préparer en amont et de ne pas découvrir une situation de handicap en plein milieu d’une séance collective.
Planifier : L’investissement le plus durable n’est pas matériel, mais humain. Plutôt que d’acheter du matériel qui risque de ne pas beaucoup servir, l’efficience réside dans la formation ciblée et continue. Il s’agit de se former en fonction des usagers que l’on rencontre, car des connaissances acquises sans application immédiate risquent de se perdre.
- Exemple concret : Un usager exprime, lors de son inscription, une difficulté liée à des tremblements ? C’est le moment idéal pour que le médiateur se forme spécifiquement sur ce point, par exemple en consultant le module dédié aux aides à la saisie sur notre MOOC autonomie-numerique.fr. La connaissance est ainsi directement mise en pratique et ancrée. Le plan consiste donc à intégrer dans l’organisation du travail des temps dédiés à cette auto-formation réactive.
Communiquer : Faire savoir que votre lieu est attentif à ces questions et dispose d’un processus d’accueil adapté. Mentionner sur vos supports de communication que vous vous efforcez de trouver des solutions pour chaque situation peut encourager des personnes, qui n’osaient pas venir, à franchir le pas. La confiance se construit aussi par la transparence sur les efforts engagés.
Conclusion : L’inclusion comme processus continu
Rendre un lieu de médiation numérique accessible n’est pas un projet avec une fin, mais une démarche d’amélioration continue. Chaque interaction avec un usager est une occasion d’apprendre et d’ajuster ses pratiques. En adoptant une posture d’écoute et une approche méthodique, chaque conseiller numérique peut devenir un maillon fort de l’autonomie pour tous les publics, sans exception.
Pour aller plus loin
L’acquisition de ces compétences est un parcours. Pour approfondir ces sujets à votre rythme et découvrir d’autres facettes de la médiation numérique inclusive, ICOM’provence met à votre disposition un MOOC complet et gratuit.
➡️ Découvrez nos modules de formation sur [https://www.autonomie-numerique.fr]
